La gauche et l’affaiblissement de l’identité nationale iranienne : analyse des relations complexes et des idéologies importées
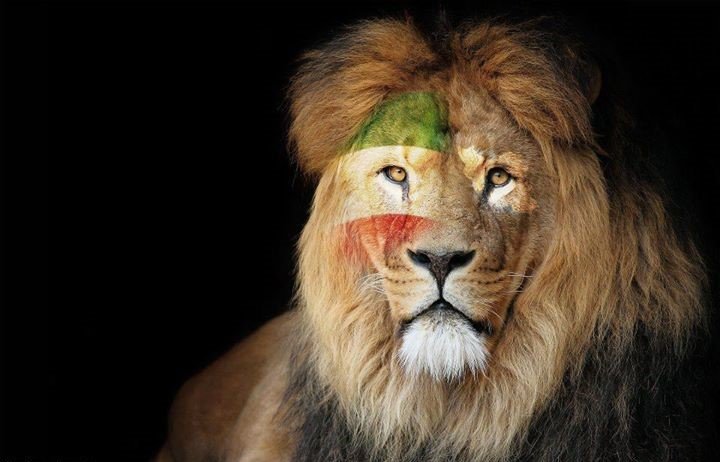
Le courant de gauche en Iran possède une histoire complexe et contradictoire. Dès son introduction, cette idéologie est entrée en scène avec des slogans flamboyants ; mais en pratique, non seulement elle n’a pas su résoudre les problèmes du peuple, mais encore, par ses actions et ses conceptions, elle a alimenté des crises sociales et culturelles. Cet article examine l’héritage des groupes de gauche iraniens, leurs actions contre la nation, et les raisons de leur hostilité envers le nationalisme et l’identité nationale.
Les origines de la gauche en Iran : de la Révolution constitutionnelle à celle de 1979
La gauche, en tant que courant intellectuel et politique, émerge en Iran à la fin de l’époque qadjare, avec l’introduction des idées marxistes. Celles-ci apparaissent d’abord chez des intellectuels en contact avec la Révolution russe. Divers groupes de gauche se forment alors, parmi lesquels les plus notables furent :
Le Parti communiste d’Iran (années 1920) : l’idéologie importée et la rupture avec l’identité nationale
Fondé en 1920, le Parti communiste d’Iran fut la première organisation marxiste structurée du pays. Il naît dans un contexte marqué par les ingérences étrangères, la faiblesse du pouvoir central et les efforts de modernisation. Pourtant, au lieu de répondre aux besoins nationaux, ce parti servit davantage les intérêts étrangers — en particulier ceux de l’Union soviétique — et s’opposa fréquemment aux valeurs et aux intérêts nationaux de l’Iran.
Fondation et idéologie
Le Parti communiste résulte de la fusion de petits groupes socialistes, dont le Parti de la Justice, à Bandar Anzali. Inspiré directement de la Révolution bolchévique et de l’idéologie marxiste-léniniste, il se dote d’un programme clair :
Égalité des classes et lutte contre le féodalisme ;
Fin de l’influence du capitalisme étranger ;
Réformes économiques et sociales profondes.
Mais ces objectifs furent dictés et supervisés par Moscou. Ils reflétaient davantage l’expansion du communisme international que les besoins concrets de la société iranienne.
Actions et pratiques
L’une des critiques majeures adressées au Parti communiste d’Iran fut sa dépendance totale envers l’Union soviétique. Dès ses débuts, il agit comme un bras politique de Moscou. Le soutien financier et militaire soviétique montrait clairement que sa priorité n’était pas le peuple iranien, mais l’avancée du communisme dans la région.
Soutien aux séparatismes : le parti encouragea des mouvements sécessionnistes dans le nord, notamment la République soviétique de Guilan. Ces initiatives menaçaient l’unité nationale et transformaient l’Iran en terrain de jeu des puissances étrangères.
Opposition aux réformes nationales : au lieu de soutenir les efforts de modernisation de Reza Shah — visant à renforcer l’État central et à réduire l’influence étrangère — le parti s’y opposa violemment, sapant toute politique à caractère national.
Évaluation historique
En dépit de ses slogans égalitaristes, le Parti communiste d’Iran échoua à rallier les masses. Son incapacité venait de sa dépendance affichée envers une puissance étrangère, de son indifférence aux valeurs nationales et de ses actions qui fragmentaient l’unité nationale. Héritage d’idéologies importées, il incarne le danger de modèles étrangers imposés sans considération pour l’histoire et la culture iraniennes.
Le Parti Toudeh d’Iran (années 1940) : l’instrument de Moscou contre les intérêts nationaux
Fondé dans les années 1940, le Parti Toudeh fut l’un des groupes de gauche les plus influents du XXᵉ siècle en Iran. Arborant des slogans de justice sociale, de défense des travailleurs et de lutte contre le colonialisme, il devint rapidement l’un des mouvements les plus controversés, du fait de sa dépendance extrême à l’Union soviétique et de son opposition répétée aux intérêts nationaux.
Fondation et objectifs proclamés
Créé en 1941 après l’abdication de Reza Shah, le parti rassembla des hommes politiques de gauche, dont Soleiman Mirza Eskandari. Ses objectifs initiaux :
Défendre les droits des ouvriers et des paysans ;
Promouvoir la justice sociale ;
Combattre le colonialisme et l’impérialisme occidental ;
Étendre les libertés politiques et sociales.
Derrière ces proclamations, le parti agissait surtout comme prolongement politique de Moscou, reléguant au second plan les intérêts nationaux.
Actions et activités
Séparatismes en Azerbaïdjan et au Kurdistan : en 1946, avec le soutien soviétique, des gouvernements autonomes furent proclamés dans ces régions. Le Parti Toudeh, loin de défendre l’intégrité territoriale de l’Iran, cautionna ces initiatives, servant ainsi d’instrument de propagande soviétique.
Infiltration de l’armée et de l’État : dans les années 1950, le parti chercha à miner le pouvoir de l’intérieur. Sa « cellule militaire », composée d’officiers, élabora des plans de coup d’État qui furent finalement déjoués et réprimés.
Opposition aux politiques nationalistes : tout projet qui contrariait Moscou fut combattu. Ainsi, lors de la nationalisation du pétrole, le Parti Toudeh refusa d’abord d’appuyer ce mouvement national, ne donnant qu’un soutien tardif et conditionnel.
Propagande anti-Pahlavi : le parti mena une campagne virulente contre les réformes modernisatrices et sociales entreprises sous les Pahlavi, notamment l’éducation et l’émancipation des femmes, en contradiction avec son discours sur la justice sociale.
Dépendance à Moscou
Le Parti Toudeh bénéficiait d’un soutien direct de l’URSS, financier et idéologique. De nombreux cadres furent formés à Moscou, qui servait de véritable centre décisionnel. Cette soumission fit percevoir le parti non comme une force nationale, mais comme un agent de l’étranger.
Évaluation historique
Malgré ses revendications en faveur des classes populaires, le Parti Toudeh servit principalement de vecteur aux ambitions soviétiques en Iran. Son alignement sur Moscou, son appui aux mouvements sécessionnistes et son hostilité aux politiques nationales lui ont aliéné la population. Symbole de l’échec des idéologies importées face aux réalités iraniennes, il reste un exemple patent de l’incompatibilité entre dogmes étrangers et identité nationale.
L’Organisation des guérilleros Fedayin du peuple d’Iran : un instrument de destruction sous couvert de lutte
Apparue dans les années 1960 et 1970, l’Organisation des guérilleros Fedayin du peuple d’Iran fut l’un des groupes de gauche les plus turbulents de l’histoire contemporaine du pays. Fondée au nom de la justice sociale et de la défense de la classe ouvrière, elle devint en réalité un instrument de chaos, de destruction et d’imposition d’idéologies importées, bien plus qu’un mouvement au service des intérêts du peuple et de la nation iranienne.
Naissance et objectifs proclamés
L’organisation fut fondée en 1970 par de jeunes militants de gauche influencés par le marxisme-léninisme. Bien qu’ils aient revendiqué la défense des ouvriers et l’instauration de la justice sociale, leurs actions portèrent de graves coups à la stabilité et à la paix du pays.
Les dirigeants initiaux — Bijan Jazani, Massoud Ahmadzadeh et Amir Parviz Pouyan — substituèrent aux traditions culturelles et nationales iraniennes des modèles idéologiques étrangers. Plutôt que d’œuvrer au changement par des moyens légaux ou culturels, ils adoptèrent la lutte armée et la stratégie de la destruction.
Les actions destructrices des Fedayin
L’attaque de Siahkal : symbole d’une violence stérile
Leur première opération armée, en février 1971, contre la gendarmerie de Siahkal, illustra clairement leur recours à la violence comme outil principal. Inspirée des mouvements guérilleros d’Amérique latine, cette action n’apporta aucun bénéfice au peuple iranien. Elle suscita au contraire peur, méfiance et désordre social.
Sabotage des infrastructures nationales
Les Fedayin, par des attentats à la bombe contre des centres économiques et des destructions de banques, affaiblirent l’économie nationale au lieu de la renforcer. Leurs slogans en faveur des ouvriers contredisaient leurs pratiques, puisque les dommages causés aux infrastructures nuisaient en premier lieu à ceux-là mêmes qu’ils prétendaient défendre.
Obéissance aveugle aux idéologies étrangères
Leur principale faiblesse fut l’incapacité à comprendre les réalités culturelles et sociales de l’Iran. En important des idéologies étrangères, ils tentèrent d’imposer un modèle non iranien à une société riche d’une civilisation millénaire.
Une gauche en opposition avec l’identité nationale
À l’instar d’autres groupes de gauche, les Fedayin se heurtèrent aux valeurs culturelles et à l’identité nationale de l’Iran. Plutôt que de s’appuyer sur la civilisation et la langue persane, ils propagèrent des idéologies qui divisaient la population en deux camps : « nous » et « eux ».
De plus, ils attaquèrent fréquemment les réalisations nationales, notamment les projets d’infrastructures et la modernisation, tentant de dresser la population contre l’ordre établi par des campagnes de noircissement systématique.
Le rôle face à la stabilité du pays
Alors que l’Iran progressait sous la monarchie sur la voie de la modernisation et du développement, les Fedayin et d’autres groupes similaires cherchèrent, avec leurs slogans vides et importés, à entraver cette dynamique. Leurs actions infligèrent au pays des coûts sociaux et économiques considérables, sans apporter la moindre amélioration pour le peuple.
Trahison sous couvert de lutte
Plutôt que d’apporter de véritables solutions aux problèmes du pays, les Fedayin devinrent un outil de destruction et de désordre. Leur parcours incarne l’échec des idéologies importées et le mépris du patrimoine national iranien.
Finalement, le peuple iranien rejeta ces groupes et leurs idées, affirmant que la voie du progrès résidait dans la stabilité, la richesse culturelle et l’identité nationale — non dans la violence ni dans des doctrines étrangères.
L’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran (années 1970) : de l’idéalisme révolutionnaire à la trahison des intérêts nationaux
Fondée dans les années 1960, l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI) demeure l’un des mouvements politiques les plus controversés de l’histoire contemporaine du pays. Créée pour lutter contre la dictature intérieure et l’impérialisme étranger, elle évolua vers un groupe paramilitaire dont les actions causèrent davantage de tort à la nation qu’elles ne servirent ses aspirations.
Fondation et idéologie
L’OMPI fut créée en 1965 par de jeunes étudiants religieux, combinant islamisme chiite et marxisme comme fondement idéologique. Ce mélange provoqua d’emblée des contradictions internes qui engendrèrent plus tard de profondes scissions.
Ses objectifs initiaux étaient :
renverser le régime des Pahlavi ;
lutter contre l’impérialisme occidental, en particulier les États-Unis ;
instaurer un gouvernement fondé sur la justice sociale et islamique.
Activités et actions
Dans les années 1970, l’OMPI entra dans une phase armée, multipliant assassinats ciblés et attentats à la bombe. Beaucoup d’entre eux causèrent la mort de civils et la destruction de biens publics.
Parmi ses principales opérations :
Assassinats de conseillers américains : ces actions visaient à dénoncer la présence militaire et économique des États-Unis en Iran.
Attaques contre les infrastructures : notamment attentats dans des installations pétrolières et administrations, perturbant le développement du pays.
Conflits avec d’autres groupes révolutionnaires
Cherchant à dominer le champ révolutionnaire, l’OMPI entra en confrontation violente avec d’autres courants politiques et religieux, multipliant les affrontements sanglants.
Alliance avec les ennemis de l’Iran
Le chapitre le plus sombre de son histoire reste son alliance avec le régime baasiste irakien durant la guerre Iran-Irak. L’OMPI collabora directement avec Saddam Hussein, participant à des opérations militaires contre le peuple et l’armée iraniens. Cette trahison la fit percevoir par la majorité des Iraniens comme synonyme de perfidie et d’hostilité envers la nation.
L’OMPI, de mouvement à secte
Après l’échec de son implantation dans la République islamique naissante, l’organisation prit le chemin de l’exil armé et se restructura sous l’autorité de Massoud et Maryam Radjavi. Avec le soutien de Saddam Hussein, elle installa des bases militaires en Irak et poursuivit ses opérations armées.
Au fil du temps, l’OMPI se transforma en une secte fermée et autoritaire, caractérisée par :
Concentration du pouvoir : les Radjavi éliminèrent les dissidents et concentrèrent entre leurs mains une autorité politique, idéologique et quasi religieuse.
Endoctrinement et contrôle psychologique : séances d’aveux collectifs, serment de fidélité absolue, coupure d’avec les familles. Les membres perdirent leur identité individuelle pour ne dépendre que du groupe.
Rigidité idéologique et religieuse : interprétation dogmatique, interdiction du mariage, divorces collectifs forcés, vie communautaire imposée.
Isolement géographique : les bases, notamment le camp d’Achraf en Irak, étaient conçues comme des lieux fermés, empêchant tout contact extérieur.
Dépendance aux puissances étrangères : la collaboration militaire et politique avec Saddam Hussein fit perdre toute légitimité nationale.
Conséquences et nature sectaire
Perte du soutien populaire : par ses violences et ses trahisons, l’OMPI devint un groupe marginal et discrédité.
Violations des droits de ses membres : témoignages de tortures, détentions internes, voire exécutions de dissidents. Les membres furent contraints d’abandonner leurs familles et de consacrer leur vie exclusivement à l’organisation.
Traumatismes des ex-membres : de nombreux anciens souffrent de séquelles psychologiques graves, liés à l’isolement et au contrôle exercés.
Isolement international : malgré ses efforts de lobbying, sa nature sectaire amena de nombreux États et ONG à refuser tout soutien public.
Échec et rejet
En définitive, l’OMPI, minée par ses contradictions idéologiques, sa violence et sa soumission aux ennemis extérieurs, fut écartée de la scène politique iranienne. Elle passa du statut de mouvement révolutionnaire à celui d’organisation honnie, y compris parmi les opposants au régime islamique.
Née avec des slogans de justice et d’indépendance, elle finit par se retourner contre la nation iranienne, au service d’intérêts étrangers. Ses violences et ses trahisons en font l’une des leçons les plus amères de l’histoire politique de l’Iran.
La gauche et son hostilité au nationalisme : pourquoi et comment
Depuis l’origine, les gauches iraniennes ont manifesté une hostilité déclarée envers l’idée de nationalisme et l’identité nationale. Cette hostilité procède de plusieurs facteurs :
Une idéologie internationaliste
Le marxisme, en général, s’oppose au concept d’État-nation. Dans cette idéologie, les frontières nationales n’ont pas de sens et la classe ouvrière mondiale doit s’unir pour renverser le capitalisme. Les gauches iraniennes ont poussé cette idée à l’extrême, qualifiant toute appartenance à l’Iran, à la langue persane et au patrimoine culturel de « nationalisme réactionnaire ».
Dépendance aux puissances étrangères
Nombre de groupes de gauche iraniens bénéficiaient d’un soutien direct de l’Union soviétique ou d’autres pays. Cette dépendance les transforma en instruments de la promotion d’intérêts exogènes. Leur appui au séparatisme en Azerbaïdjan et au Kurdistan en est un exemple emblématique.
Aversion pour la civilisation iranienne
Au nom de la lutte contre le « despotisme historique », les gauches iraniennes s’en sont prises au patrimoine culturel de l’Iran. Elles ont qualifié la langue persane « d’outil de domination » et dénoncé les fêtes nationales, comme Norouz, comme « réactionnaires ».
Échec idéologique et fabrication de crises nouvelles
Avec l’effondrement du marxisme dans le monde et la chute de l’URSS, les gauches ont cherché de nouveaux récits pour survivre. Elles se sont alors tournées vers les questions identitaires – ethnies, genres, minorités religieuses – attisant les divisions afin d’affaiblir l’identité nationale.
Les actions de la gauche contre la nation iranienne : du séparatisme au terrorisme
Le Parti Toudeh et d’autres groupes de gauche, en excitant les Azéris et les Kurdes contre le pouvoir central, ont visé la création d’entités locales inféodées à l’URSS. La République de Mahabad au Kurdistan et la Ferqa-ye Démocrate d’Azerbaïdjan en sont des exemples patents.
Les gauches, en particulier le Parti Toudeh, ont soutenu l’occupation de l’Iran par l’Armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale et ont même plaidé pour le maintien des forces soviétiques dans le pays.
Les guérilleros des Fedayin du peuple et les Moudjahidines du peuple (OMPI) ont, dans les années 1970, entretenu une insécurité généralisée par des assassinats de responsables, des attaques contre des lieux publics et des attentats à la bombe.
Pendant la guerre Iran-Irak, l’OMPI collabora ouvertement avec Saddam Hussein, se livrant à des opérations militaires et à des activités d’espionnage contre l’Iran.
Les contradictions des gauches iraniennes
Tout en clamant la lutte contre « l’impérialisme », les gauches iraniennes se sont, dans les faits, changées en instruments des puissances étrangères. Elles n’ont jamais dénoncé les crimes de l’URSS, de la Chine ou d’autres régimes communistes, et les ont systématiquement soutenus.
De même, se prétendant défenseures des « droits des ethnies et des minorités », elles ont ignoré la répression des peuples dans les pays de gauche comme l’URSS et la Chine. Ces contradictions montrent que leur hostilité au nationalisme procède moins de principes idéologiques que de dépendances et d’intérêts politiques.
La gauche culturelle : une nouvelle hostilité au nationalisme
Ces dernières décennies, au lieu de se concentrer sur la lutte politique, les gauches iraniennes ont investi la « gauche culturelle ». Par les médias, l’art et l’université, elles diffusent l’idée que le nationalisme serait un « fascisme moderne ».
Elles présentent la langue persane comme « un instrument d’oppression des ethnies », les fêtes nationales comme « des symboles de despotisme » et les emblèmes historiques de l’Iran comme « réactionnaires ». Le but ultime de ce courant est de saper l’identité nationale et de fabriquer une société privée de cohésion.
Comment répondre au courant « gauchiste » antinational
Le gauchisme antinational, historiquement lié à la dépendance vis-à-vis de puissances étrangères et à l’affaiblissement de l’identité et des intérêts nationaux, demeure un défi intellectuel et politique. Plutôt qu’une riposte superficielle, il faut une approche multidimensionnelle pour en miner les bases théoriques et pratiques. Voici des pistes d’action complètes :
1. Renforcer l’identité nationale et historique
L’un des outils majeurs de ce courant consiste à dénigrer les symboles historiques et culturels. Il faut donc affirmer l’identité nationale comme valeur commune.
Enseigner la véritable histoire de l’Iran : des origines à nos jours, sans travestissement, en soulignant les accomplissements nationaux.
Promouvoir la culture et l’art iraniens : littérature, musique, arts visuels, comme remparts contre l’agression idéologique.
Revivifier les rites nationaux : Norouz, Mehrgân, Yaldâ, comme pivots d’unité et d’iranité.
2. Clarifier et informer sur la nature du gauchisme antinational
L’histoire contemporaine a révélé, à maintes reprises, le caractère dépendant et destructeur de ce courant.
Mettre au jour les trahisons historiques : collusion du Toudeh avec l’URSS, attentats de l’OMPI, alliances avec Saddam pendant la guerre.
Éduquer le public : documentaires, analyses, programmes sur l’impact délétère des idéologies de gauche en Iran et ailleurs.
Surveiller et contrer les falsifications médiatiques : répondre de façon argumentée aux narratives mensongères.
3. Fortifier l’économie nationale pour réduire la vulnérabilité sociale
Le gauchisme antinational exploite souvent les difficultés économiques avec des slogans populistes.
Soutenir la production intérieure et l’emploi durable.
Réduire les inégalités par des politiques de répartition plus équitable.
Valoriser la culture du travail et de l’effort, contre les réflexes d’assistanat.
4. Restaurer la confiance dans les institutions nationales
Les gauches exploitent les failles institutionnelles pour miner la confiance publique.
Transparence et redevabilité des institutions, lutte contre la corruption.
Soutien à la société civile : associations et fondations ancrées dans l’éthique et l’identité nationales.
Promotion des valeurs civiques et morales : droits citoyens, probité, solidarité.
5. Défendre la place de l’Iran dans la région et le monde
Le gauchisme antinational veut rabaisser l’Iran sur la scène internationale, instillant un complexe d’infériorité.
Mettre en avant les capacités iraniennes : progrès scientifiques, culturels, économiques.
Diplomatie national-centrée : les intérêts de l’Iran priment sur toute idéologie importée.
Raviver la fierté nationale en rappelant les contributions de l’Iran à la civilisation mondiale.
6. Endiguer l’influence des idéologies importées
La gauche en Iran a presque toujours été greffée de l’extérieur.
Valoriser la pensée endogène : penseurs puisant des solutions dans la culture iranienne (et islamique) pour les questions sociales et politiques.
Réformer l’enseignement afin d’éviter la diffusion d’idées dévoyées dans les milieux académiques et culturels.
Protéger l’iranité face à la mondialisation débridée, en conciliant ouverture et sauvegarde des valeurs nationales.
7. Affermir les leaders et symboles nationalistes
Des figures intellectuelles et politiques vouées à la défense des intérêts nationaux sont indispensables.
Soutenir les élites nationalistes et créer des espaces pour leur émergence et leur action.
Réhabiliter les personnalités historiques : Reza Shah, Mohammad-Reza Shah et d’autres symboles nationaux, auprès de la jeunesse.
8. Unir le peuple et l’État après la République islamique
Un objectif des gauches est d’élargir le fossé entre la population et l’État.
Écouter les revendications de toutes les couches sociales.
Transparence et lutte anticorruption pour renforcer la confiance.
Exalter les valeurs nationales comme base de la cohésion peuple–État.
Le nationalisme n’est pas l’extrême droite
Après avoir critiqué les gauches et leurs effets néfastes, il importe de distinguer clairement nationalisme et droite radicale, pour dissiper toute ambiguïté et contrer les amalgames. Les gauches tentent parfois d’assimiler le nationalisme à l’extrémisme, afin d’affaiblir l’identité et la solidarité iraniennes. Or ces deux idéologies diffèrent, et même se contredisent souvent.
Le nationalisme est un mouvement culturel et politique qui insiste sur l’identité, l’indépendance et les intérêts de la nation iranienne. Il promeut la culture, la langue et l’histoire de l’Iran, ainsi que l’unité de toutes les composantes de la société dans les frontières du pays. Les individus s’y reconnaissent comme membres d’une grande nation ; l’objectif est de protéger l’Iran, sur les plans culturel et social, contre les menaces internes et externes.
La droite radicale, à l’inverse, met l’accent sur des identités fermées — ethniques, religieuses ou raciales. Elle recherche une société « pure » et exclusive selon des critères particularistes, nie la diversité culturelle, et marginalise les groupes jugés « non conformes ».
Assimiler l’un à l’autre est un sophisme. Les nationalistes cherchent la cohésion nationale et la sauvegarde de l’identité et de l’indépendance ; les extrémistes prônent l’exclusion. Pour prévenir toute confusion, il faut affirmer que le nationalisme, force de construction et d’unification, n’a rien à voir avec l’idéologie de fermeture propre à la droite radicale.
En bref, les nationalistes doivent rappeler sans relâche le respect dû à toutes les composantes ethniques et sociales de l’Iran, et déjouer les amalgames que les gauches exploitent pour attaquer l’iranité. Ni les adversaires de l’Iran, ni les gauches qui attisent la division, ne devraient pouvoir travestir le sens du nationalisme. Les nationalistes défendent l’intégrité territoriale, culturelle et historique du pays ; ils ne prônent ni l’exclusion ni le mépris de la diversité.
Au final, du Parti communiste iranien des années 1920 aux groupes de gauche ultérieurs, l’on a vu des courants qui, au lieu de renforcer la solidarité nationale, ont semé la division et combattu les principes nationaux. Il convient donc d’éclairer les différences fondamentales entre nationalisme et extrême droite. Les nationalistes iraniens valorisent l’unité, la culture et l’indépendance ; l’extrême droite recherche des identités closes et exclusives.
Les gauches, toujours promptes à saper le nationalisme, doivent assumer leurs actes. Pour fortifier l’iranité et contrer le gauchisme antinational, il faut concentrer les efforts sur l’unité nationale et la préservation des principes culturels et historiques du pays. Le nationalisme doit s’affirmer comme une force constructive et fédératrice au service des objectifs de l’Iran.
Ehsan Tarinia – Luxembourg
Écrit le 29 décembre 2024
